«Je ne vais jamais tout mettre sur la table comme un all-in du poker. J’ai toujours été dans des logiques de croissance. Tout le monde n’a pas le ‘luxe’ de reprendre le business de ses parents ou de ses grands-parents. Tu n’as pas forcément le droit à l’échec au Luxembourg, c’est trop petit!»
Dans une salle de réunion baignée d’un soleil d’hiver où l’on peut voir Raiffeisen et Lalux, le CEO de Finologee, Raoul Mulheims, a accepté d’essayer de résumer sa vie d’entrepreneur en 20 dates. Cela fait 20 ans qu’il s’est lancé dans l’aventure, régulièrement renouvelée.
Sa particularité? Être «né» à l’époque de l’entrepreneuriat avec internet, en avoir compris directement le potentiel, à l’heure où les parents de jeunes Luxembourgeois leur disaient: «Passe ton bac d’abord, tu seras fonctionnaire!»
1. 1993, la radio locale
«J’avais 16 ans. Quand les fréquences ont été libéralisées au Luxembourg, il y a d’abord eu la création des radios régionales, puis les fréquences locales, avec des appels d’offres pour postuler. Avec des copains du quartier à Bettembourg, on s’amusait à faire un peu de radio pirate depuis 1989. On était tout contents d’émettre jusqu’à Howald! Mon père avait trouvé ça amusant comme hobby, comme mon frère, plus jeune de deux ans était aussi impliqué. Alors il nous a soutenus pour introduire un dossier. RLB est née, qui existe toujours aujourd’hui (Radio LRB). Subventionnée par les Communes de Bettembourg et de Roeser. C’était ma première participation à un cahier des charges pour monter le studio, pour demander des offres de la table de mixage, des micros, etc., mais aussi pour le logo et le marketing. J’ai appris à organiser, à structure, à accompagner l’initiative. Ça a duré deux ou trois bonnes années, et j’étais moins actif ensuite. C’était une époque très marrante! Avec des feed-back au lycée! Tu venais avec tes CD, tu les passais et on s’amusait ! On essayait d’avoir du contenu éditorial. J’ai beaucoup appris, surtout à être exposé aux critiques et à défendre la liberté de la presse… Surtout quand les maires appelaient!»
2. 1996, Luxusbuerg, le Facebook local avant Facebook
«Luxusbuerg était à l’époque vraiment un chouette phénomène! En 1995, début 1996, c’était les premiers Luxembourgeois sur internet. Et la première chose que tu fais, c’est d’aller chercher d’autres Luxembourgeois sur internet! Tu découvres le monde. Les salons de discussion sont déjà répandus et techniques, avec un logiciel spécifique. En organisant ça avec ceux qui restaient le plus longtemps la nuit, j’avais le temps d’en faire une vraie plate-forme. On a créé notre propre réseau aidé par Post. C’était Tom Kettels, notre correspondant à Post. Ils mettaient un serveur à disposition, et nous faisions de la pub pour le compte de Post. C’était la page la plus visitée! Ça tirait le trafic, on était à 70.000 utilisateurs! On était loin devant RTL, le Wort et les autres! C’était 10 ans avant Facebook, et le pic est arrivé pour nous vers 2002. Après, il y avait aussi MySpace. On avait créé Nvision en 1999, et l’énergie qu’on y mettait n’était plus la même. On a réuni des soirées, on avait des chat meetings par salon, un par mois, avec des équipes d’animateurs par salon, avec une vingtaine par salon. Tout était en luxembourgeois, puis on a créé un salon en français, c’était la révolution, on parlait aussi en français!»
3. 1998-1999, les avant-gardistes
«Au-delà du succès de Luxusbuerg, pour laquelle on aura jusqu’à 100 animateurs-modérateurs bénévoles, émergent les pionniers de l’information. Le premier Explorateur Cocktail de Mike Koedinger a eu lieu en 1998. Le Centre de recherche public Henri Tudor demande à son New Media Group de diffuser sa première conférence de presse sur internet. Le Lëtzbuerger Land signe le premier papier, commandé par Jean-Lou Siweck, sur les fournisseurs d’accès à internet au Luxembourg, parce que j'avais recensé tous les FAI du Luxembourg sur providers.lu.»
4. 1999, une vision, Nvision
«Trois des quatre membres fondateurs de Nvision étaient issus de Luxusbuerg. L’esprit d’entrepreneuriat était présent, mais le risque n’était pas très élevé. Nvision arrive en 1999. Avant l’explosion de la bulle en 2001. La motivation était absolue, avec tout ce que tu entendais sur les États-Unis et sur les projets qui se montaient ici. Le début de l’internet luxembourgeois, c’est 1995. Là encore, c’est le soutien de nos parents qui a fait la différence. Je commençais ma maîtrise en droit à Paris. Il y avait Mike, qui avait bossé, avant, 10 mois pour une agence de com, et Christophe Leesch venait de commencer ses études en informatique, et Mehran Khalili. Je faisais les allers-retours entre Paris et Luxembourg. J’avais mis tous les cours du lundi matin au mercredi soir. Je revenais au Luxembourg pour commencer le jeudi à bosser. C’était déjà extrêmement épuisant. C’est la seule année où j’ai décroché le diplôme à la session de septembre... Et j’avais besoin de grandes vacances à nouveau!»

Nvision, première aventure sérieuse pour Raoul Mulheims. (Photo: Nvision)
5. 1999, du Melusina au Check Inn
«À l’époque, le Melusina fermait à trois heures et demie... quand la police arrivait. Et tout le monde partait au Check Inn. Tu pouvais rentrer par la porte à l’arrière à tarif réduit, et ça fermait à six heures. On était en discussion depuis début octobre 1999 à quatre pour créer Nvision. Comme Mike était le seul à pouvoir être à plein temps et l’employé numéro 1, il fallait le convaincre de s’engager là-dedans! D’être celui qui travaille pour de vrai! Il a dit oui vers 5h30. On s’était bien amusés. Mais le jour d’après, ce n’était pas oublié. Le risque était assez limité. On se lançait là-dedans, insouciants, étudiants, on n’investissait pas à acheter de la matière première, c’était surtout un investissement en énergie et en temps. On avait déjà eu une validation, mon père avait un bureau d’ingénieur, et ma mère était fonctionnaire d’État. Les deux avaient leurs arguments pour aller dans l’une ou dans l’autre des directions. Je leur ai dit que je voulais tenter ceci. J’ai dû négocier avec mes parents pour rentrer au capital, avec un quart du capital, les 500.000 francs, les 3.125 euros qu’il fallait. Après, il fallait apprendre à travailler!»
6. 1999, le projet de Nvision qui voit le jour aujourd’hui
«On avait six produits principaux, dont la plate-forme de chat, ou une base de données juridique pour vendre aux avocats au Luxembourg. Ou une plate-forme pour des Communes pour qu’elles interagissent avec leurs concitoyens, ce que le Sigi a ensuite partiellement fait. Tu as 23 ans, tu vas présenter ça à des échevins… ‘Qui me dit que, dans deux ans, vous serez encore là’, nous répondaient-ils. On s’est concentrés sur Luxusbuerg. Après un an, on vivait un peu sur les assets initiaux, mais on faisait de l’argent. On a commencé à faire des sites internet, ce qu’on fait encore aujourd’hui. Tout le monde se lançait là-dedans. Les programmeurs ne maîtrisaient pas le design, les boîtes de com ne maitrisaient pas la programmation, et les petits jeunes faisaient tout comme ils pouvaient.»
7. Fin de l’été 2000, maîtrise en droit
«La maîtrise en droit, ça rassure mes parents. Je ne sais pas si on en a parlé ouvertement. Mais c’était quelque chose pour moi. Avoir un truc solide, même si je n’ai pas continué avec les cours complémentaires en droit luxembourgeois. J’avais déjà commencé à faire de mon hobby mon activité. Ça m’a aidé de savoir que, si ça tourne mal, tu peux faire autre chose. Et il y a un savoir-faire, juridique, qui nous a permis d’avancer. C’était un avantage compétitif aussi. Ça m’aide encore aujourd’hui, le côté ‘compliance’, je comprends. J’ai une certaine expertise. Ce que j’ai découvert ensuite, c’est que ça facilite énormément le travail avec les IT, avec les informaticiens. Ils ont le même type de réflexion. Même si tu es sur deux matières complètement différentes, la manière de réfléchir, de s’interfacer et de présenter les informations, c’est pareil.»
8. 2002, premier site de l’eGovernment
«La Protection civile, comme premier client, c’était important parce que c’était le quatrième ou le cinquième projet d’eGovernment. Le gouvernement avait lancé, à l’époque, pour optimiser sa présence sur internet, le programme eLuxembourg, et ils le morcelaient de telle manière que les acteurs locaux puissent participer. Ils auraient pu faire un appel d’offres pour un million d’euros pour les gros fournisseurs de services. Mais ils n’ont pas fait comme ça. Ils ont aussi accompagné les projets. Au début, les habituels de la Place, les Telindus et autres, ont porté ces projets-là, mais on a eu le quatrième appel d’offres en 2001, le plus gros projet de l’époque, le portail de la Protection civile. Un vrai moment-clé aussi, qui prouvait qu’on réussissait à s’installer comme acteur crédible et légitime. Avant, on avait pas mal de projets en préparation, pour Binsfeld. C’était bien, mais on était plutôt en retrait. Comme des fournisseurs. Là, on rencontrait les mastodontes!»
9. 2003, Cupidon, autre première
«En 2003, Cupidon voit le jour, la première application mobile sur le WAP, l’internet mobile de l’époque pour Post, ce qui nous offre le premier contact avec les infrastructures SMS des opérateurs mobiles. Ça aura son importance par la suite.»
10. 2004, paiement et routage au menu
«On avait fait d’abord un développement pour Post. L’idée de faire une plate-forme de gestion de SMS et de routage. Post aurait pu reprendre cette activité, mais ils n’étaient pas réellement intéressés, donc on a trouvé un accord pour une exploitation commerciale. Avec tarifications, règles, code de conduite, gouvernance entre opérateurs, il n’y en avait que deux, avec Tango. On a créé cette plate-forme intermédiaire qui faisait et qui fait toujours deux choses: micropaiement par mobiles, par SMS, et routage entre applications et téléphones (notifications critiques, activations de Luxtrust, messages marketing). On a créé le gateway.»
11. 2006, Mpulse surfe sur les SMS
«C’était le début. On allait au-delà du Luxembourg, vers la Belgique, la France et l’Allemagne. On observait ces écosystèmes de paiement par SMS, c’était complètement fou à l’époque. C’était des acteurs de contenu mobile, il n’y avait pas de smartphones, donc c’était des sonneries de téléphones mobiles, des jeux, des logos. Du contenu adulte. C’était très porteur, avec des publicités. À partir de 2007-2008, l’activité a baissé, avec l’arrivée des smartphones. L’écosystème a été repris par Apple.»
12. 2006, départs et arrivées
«Il n’y a pas eu de drames. Du quatuor des débuts, Mehrann et Christophe étaient sortis, le premier pour partir à l'étranger, et le second pour devenir fonctionnaire. À ce moment-là, avec Mike Sergonne, on se demandait comment évoluer. On n’avait pas exclu de s’associer à d’autres. Pour avoir les compétences et les vues d’autres personnes. Christophe Goossens, à l’époque, était directeur du marketing chez Tango. Il est venu chez nous avant de repartir pour RTL un an après, Berwick l’avait engagé tout de suite pour être son numéro 2. Georges Berscheid est arrivé pour rester. Je le connaissais du lycée, il était en classe avec mon frère, deux ans à l’Athénée, il était impliqué aussi dans Luxusbuerg. Comme il venait de terminer son CDD chez IBM en Californie, on a discuté. C’était plutôt une évolution, l’âge adulte, une volonté de croissance, une nouvelle activité! On a cherché de nouveaux alliés pour aller plus vers la direction initiale, une boîte de produits Mpulse, plutôt que de services comme avec Nvision.»
13. 2006-2008, premiers grands clients
«Les premiers grands clients, ça change quelque chose, ça te booste. Tu vois clairement. Pour ArcelorMittal, ils avaient publié un appel d’offres international en tant qu’Arcelor. On l’avait remporté parmi 20 agences internationales. C’était vraiment chouette. Là, d’une certaine manière, on s’est dit qu’on pouvait jouer dans la cour des grands. Sauf qu’il y a eu l’OPA de Mittal deux semaines avant qu’on lance le site. Le site a été lancé. Et la com a migré à Londres, et on n’était plus vraiment éligibles… Avec SES Astra, autre grand client, on a commencé petit, en concurrence avec des agences internationales. Ils n’avaient jamais travaillé avec des agences locales. On s’est structuré de manière à pouvoir travailler avec eux. On a commencé à avoir de vrais seniors qui travaillaient sur ces dossiers-là. Nous n’étions plus une bande de jeunes. Quand on parlait d’experts d’internet, on était cités, une chouette évolution.»
14. 2009, Mpulse s’exporte, Prince arrive
«On avait commencé à préparer ce qui est arrivé en 2009-2010 avec Mpulse France. On voulait répliquer notre projet, on a regardé les marchés périphériques. On a créé notre première société à l’étranger, à Thionville. Discuté des accords avec les opérateurs français. On maîtrisait la langue, on n’était pas très loin. Eux nous avaient dit que ça prendrait moins de temps si nous pouvions créer une société française. Jonathan Prince avait rejoint l’équipe, au départ comme business developer.»

2010, Sergonne et Mulheims remportent le premier prix de l’ICT décerné par Paperjam. (Photo: collection Raoul Mulheims)
15. 2010, la R&D change la donne
«Il y avait une nouvelle loi pour la recherche et le développement, entrée en vigueur en 2009. Sur cette base, on a soumis un dossier pour porter l’activité de paiement mobile à une autre échelle. On ne savait pas ce que ça allait devenir, ni même comment le faire. Est-ce qu’on passe par un opérateur bancaire, par un opérateur mobile, est-ce qu’on essaie avec la facture d’électricité, comment déclencher cela? Il fallait faire ce travail de recherche, de fond, d’étude et de développement. De là, à partir de 2010, est née Digicash. Là, c’était la découverte.»
16. 2010, l’entrepreneur se pose
«On générait des bénéfices, depuis 2007-2008, beaucoup plus élevés que ceux que nous générions auparavant. Ça commençait à devenir intéressant. Mais là, il y a un risque en tant qu’entrepreneur, quand tu as lancé deux activités, deux piliers, le risque diminue et tu risques de te reposer sur tes acquis et de ne plus y aller à 120 à l’heure. C’est un moment charnière. On se demandait si on allait se lancer encore une fois dans une nouvelle activité, ou si on allait continuer quelques années et voir ce que ça donne. J’ai réalisé à ce moment que je ne pouvais pas déléguer certaines choses. Il fallait que je mette les mains dans le cambouis. Au lieu d’engager un project manager qui va le faire, qui n’a pas une réflexion d’entrepreneur, j’avais réellement envie de faire le nécessaire pour que ça fonctionne.»
17. 2012, Digicash voit le jour avec la BCEE
«Pour un Digicash, se dire que tu ne sais pas encore comment ça va fonctionner, mais tu fais le nécessaire avec le marché pour que ça fonctionne. Aller voir tous les opérateurs mobiles, toutes les banques, te bagarrer pour avoir les meetings avec les executives. Tu n’abandonnes pas. Tu vas au bout des choses. Quand tu as une sorte de tranquillité avec ton activité, il faut se soumettre à cet électrochoc. Je n’avais pas la cinquantaine non plus, mais après 10 années passées à courir, à être le chef de meute, c’était une remise en question. Revenir à des choses plus basiques! Les rendez-vous, l’organisation de projets, les comptes rendus, les prendre en main, innover, remettre en question ce qu’on pensait savoir, prendre des risques, parfois réputationnels, qui ne sont pas nécessaires quand tu n’es pas dans une logique d’innovation. Vient alors le risque financier. Il fallait investir. Au début, on ne savait pas comment faire de l’argent avec ça! Les bénéfices des autres activités nous permettaient de financer, mais on a chacun investi dedans, on a fait un prêt, recouru à la SNCI… Ça devient sérieux. On a découvert ce risque beaucoup plus sérieux.»
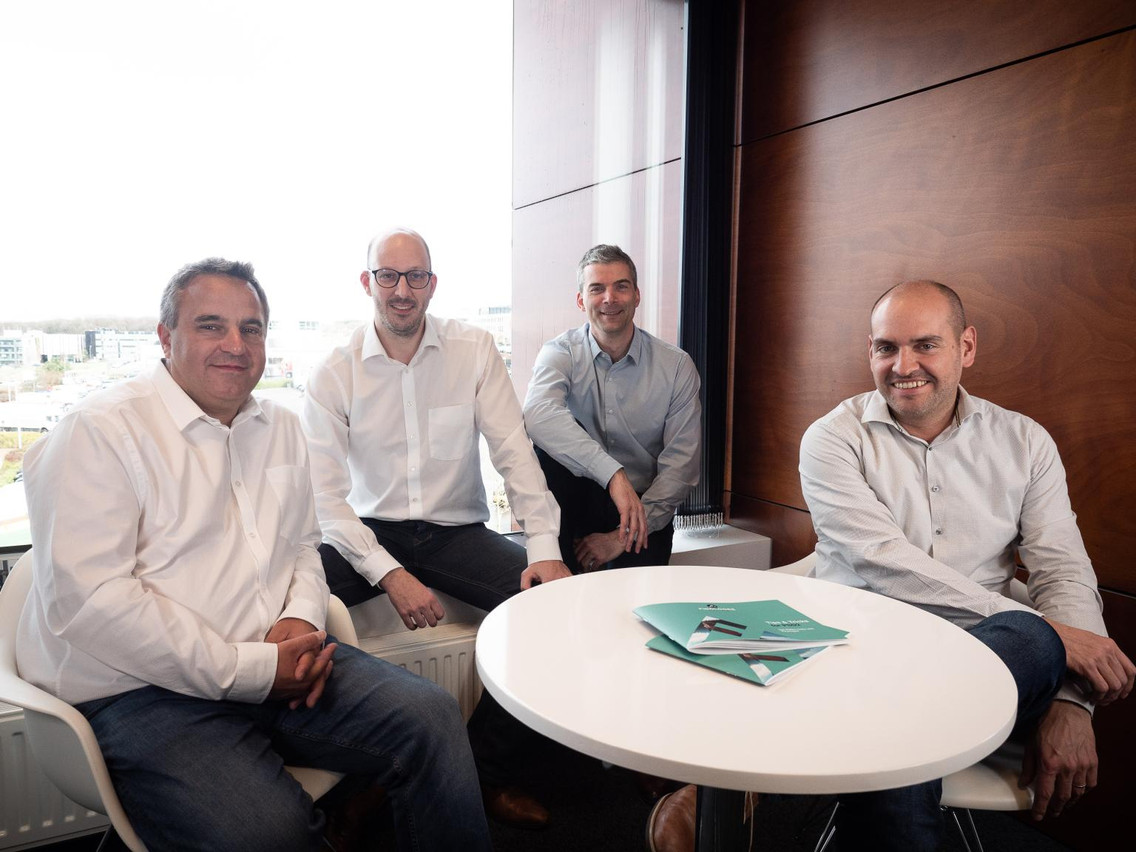
Mike Sergonne, Georges Berscheid, Jonathan Prince et Raoul Mulheims, les quatre mousquetaires de Digicash. (Photo: Digicash)
18. 2015, Flashiz-Digicash, un match vite terminé
«Au début de Digicash, il y avait trois outils de paiement, mais le troisième n’était pas soutenu par une banque, Paycash, devenue Mercedes Pay ensuite. Au-delà de Digicash–Flashiz, il y avait surtout deux camps du côté bancaire, la BCEE qui soutenait Digicash, et Flashiz était soutenue par BGL. On l’a surtout vu avec les commerçants. Un mouvement d’un des deux avec un commerçant provoquait directement une réaction de l’autre côté avec un autre commerçant. Alors qu’on surestimait leur intérêt pour ces solutions… C’était une époque passionnante, on était sur un produit consommateur et en travaillant avec une banque. Se frotter au marché entier et avoir des rendez-vous avec les directeurs de la grande distribution et faire évoluer le produit, au quotidien, en surveillant ce que faisaient les autres. Il y a une déperdition, parce que les efforts sont faits en double. Mais d’un autre côté, avec la motivation, l’effet multiplicateur, ça te fait avancer beaucoup mieux que si tu es seul sur le marché. Quand Flashiz a baissé pavillon et a été vendu, la BGL a rejoint Digicash, en 2015. On voyait que c’était plus facile avec les banques, plus facile avec certains acteurs. Le gouvernement disait, c’est la solution légitime, on l’adopte et on l’intègre. Mais tout à coup, tu n’es plus dans l’urgence pour prendre des décisions, il y a des calculs politiques… La concurrence doit être saine. Et fair, pas besoin de coups bas!»
19. 2017, l’exit de Digicash
«On a commencé les discussions à partir de la fin 2016 avec le CEO de Payconiq. C’était une opportunité. Pour atteindre une nouvelle étape, il fallait d’autres moyens. La manière d’y arriver pouvait prendre différentes formes. Une option était même de chercher un investisseur qui a les reins plus solides que nous. On était arrivés aux limites pour booster le produit et aller au-delà des frontières. C’était un acteur compatible avec ce que nous faisions parce qu’il était ‘bank friendly’, ils étaient détenus par ING et KBC avec l’ambition de conquérir l’Europe. Il y avait tout un travail de conviction à faire, quand nous avons démarré les discussions. On cède notre participation mais on a gardé la propriété intellectuelle et la marque, et on est devenu prestataire exclusif pour le Luxembourg. C’est la première fois qu’on s’est retrouvé confronté à une opération de fusion-acquisition avec la découverte de tout le processus, les avocats, les clauses, les obligations… À travailler de sept heures du matin jusqu’à trois heures du matin. C’est un drôle d’exercice. Je n’aimerais pas être un avocat qui ne fait que ça! ll faut faire attention à tout, mais comme ça prend beaucoup de temps, tu apprends à connaître tes contreparties et comment tout le monde est dépendant les uns des autres. Tout le monde a intérêt à se comporter en bon partenaire. Ça mitige le risque.»
20. 2017-2020, Finologee comme un nouveau départ
«Pourquoi Finologee? On avait l’impression qu’on avait encore certaines choses à faire, mais dans une autre configuration. On n’avait jamais eu affaire avec la CSSF avant Digicash. La finance est un secteur très intéressant, avec beaucoup de choses à faire. Au-delà des paiements, on voyait de grandes opportunités du côté du KYC et de l’anti-blanchiment, de la PSD2 et paiements alternatifs. On a commencé à préparer le terrain tout en continuant l’activité Mpulse et Digicash, et à construire les produits. On a compris qu’on devrait avoir un nouvel agrément, sinon on ne pourrait pas avancer comme on voulait. On a commencé à constituer le dossier à partir de début 2018. Ça a pris 12 mois, c’est plus long que pour Digicash, on avait mis six mois. Mais les circonstances ont changé, les exigences aussi. Elles sont plus élevées en termes de documentation, d’allers-retours. Pour lancer une activité, douze mois, c’est long. Douze mois d’attente avant de pouvoir signer ton premier client. La première date de PSD2, c’était mars 2019. Aujourd'hui, Finologee compte 30 banques connectées à sa plate-forme PSD2, et en novembre, nous avons lancé le produit KYC Onboarding avec Keytrade Bank.»
