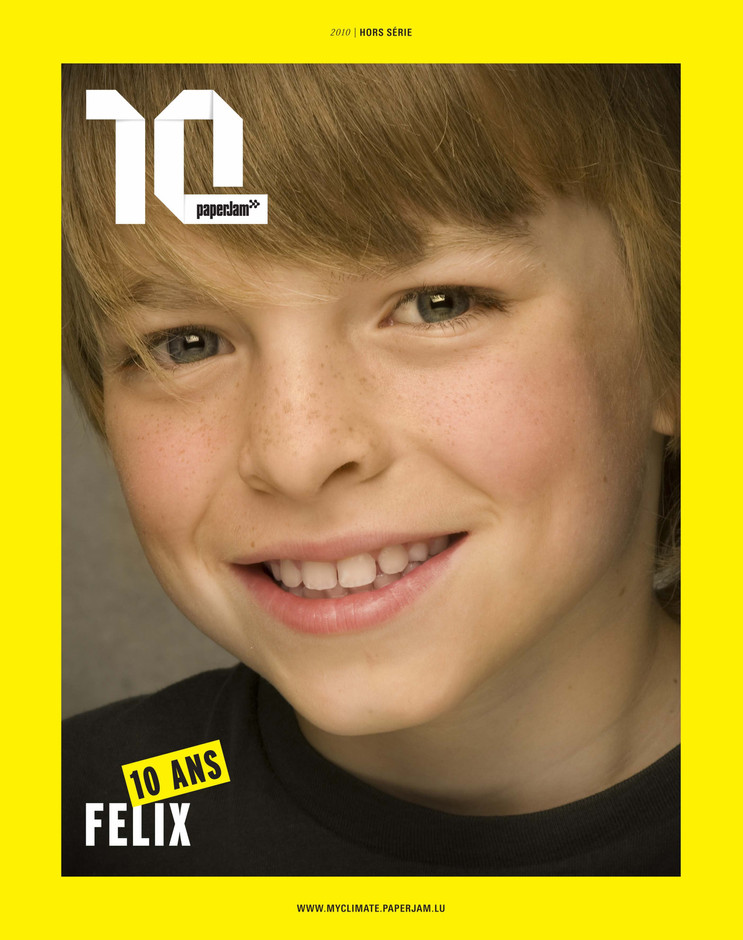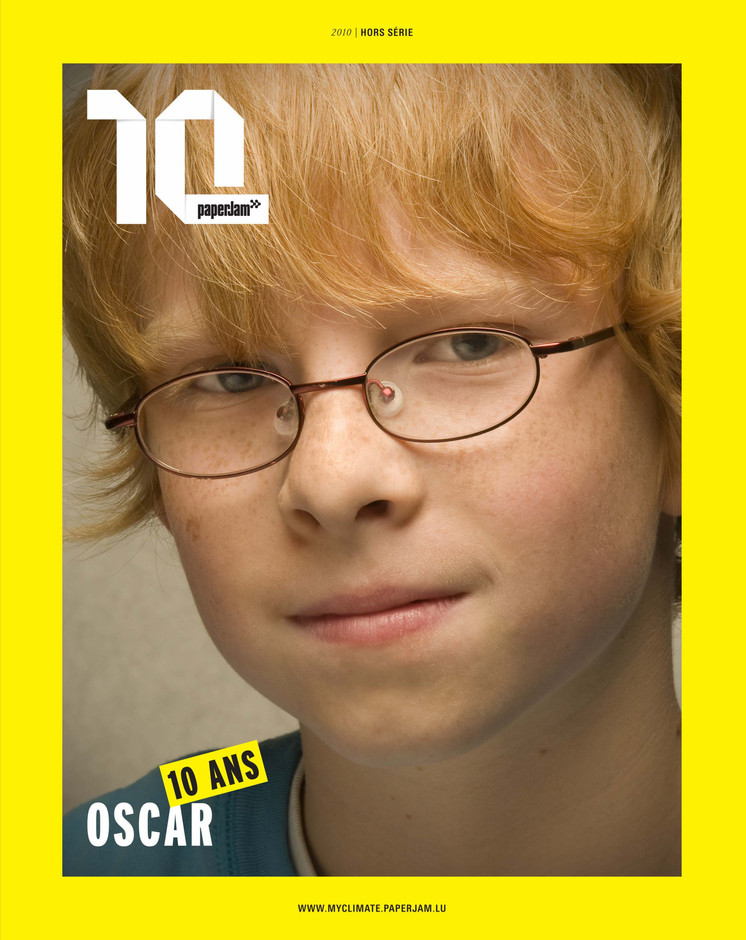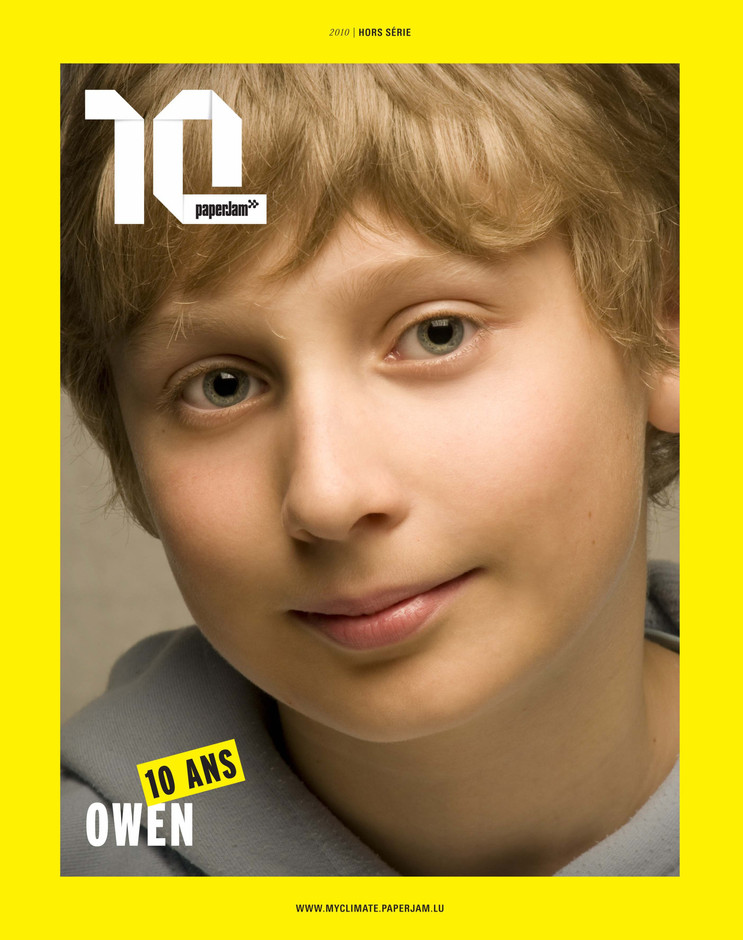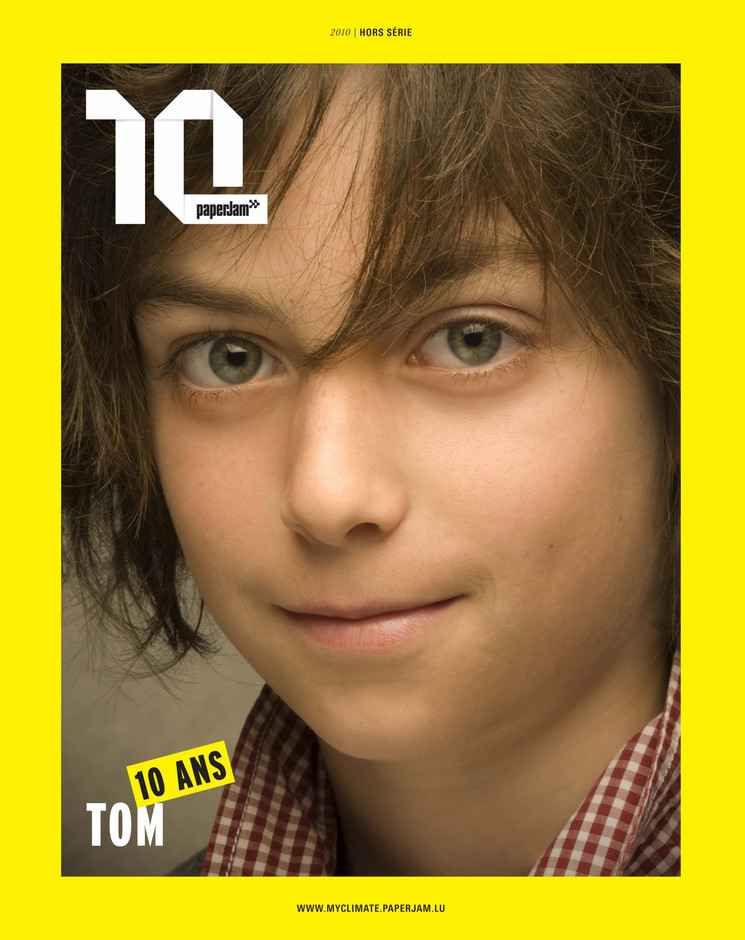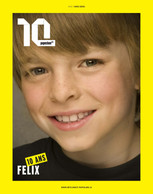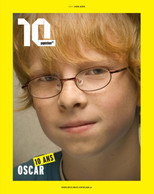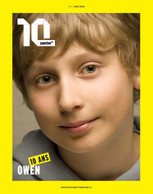En 2010, le directeur de la Fédération des artisans, , s’était prêté au jeu et avait tenté de deviner à quoi ressemblerait le Luxembourg en 2020.
Le texte de Romain Schmit
«Une majeure partie de l’économie luxembourgeoise de l’an 2020 continuera à être marquée, comme aujourd’hui, d’ailleurs, et sans que personne ne semble trop le remarquer, par les entreprises artisanales. Dans cette contribution, je vais donc essayer de décrire certaines (r)évolutions qui devraient avoir lieu les 10 prochaines années dans ce secteur que je crois assez bien connaître.
Pour le secteur de l’artisanat, l’horizon 2020 se présente sous différents aspects, tantôt positifs, tantôt inquiétants. Les bonnes nouvelles d’abord: il y aura toujours des entreprises artisanales, tant du côté des entreprises de quartier et de proximité que des structures autrement plus importantes qu’aujourd’hui. La population aura toujours besoin de boulangers et de bouchers, de coiffeurs et de cordonniers. De ce côté-là, peu d’inquiétudes, donc!
Et les entreprises artisanales continueront à prendre de plus en plus d’importance en termes d’emploi. Au cours des 20 dernières années, elles ont plus que doublé leur taille moyenne en termes d’emploi, et cette évolution continuera. De 14 personnes en moyenne aujourd’hui, je prends le pari qu’elles en occuperont en moyenne une vingtaine en l’an 2020. Ceci n’empêchera pas qu’il y aura toujours des micro-entreprises comptant entre une et cinq personnes occupées, tout comme certaines entreprises, qui sont très importantes aujourd’hui déjà et actives dans les services aux particuliers et aux entreprises, continueront à croître et à occuper plus de 1.000 personnes.
Dans les domaines de la construction, des équipements techniques et de la mécanique, surtout, le champ d’activité des entreprises artisanales s’agrandira grâce à l’évolution continue du droit d’établissement et à la formation des chefs d’entreprise. L’assimilation par les entreprises existantes des activités à connexité technique avec l’activité principale initiale, tout comme la demande de la clientèle pour un prestataire unique capable d’offrir une solution d’ensemble, favorisera cet état de fait. Leur offre de services sera plus intégrée et complète qu’aujourd’hui et, grâce à la technologie et à l’innovation toujours plus poussées au sein de ces entités, elles constitueront le ‘backbone’ incontournable de l’économie entière.
L’artisan, un partenaire
Offrant une grande flexibilité et une réactivité lui permettant de répondre à toutes les demandes des clients potentiels, le secteur continuera à proposer ses services tant aux clients particuliers qu’à l’industrie, au commerce ou aux professionnels du secteur financier, les entreprises étant souvent qualifiées de PSF elles-mêmes. La course vers la rationalisation et la spécialisation dans d’autres secteurs offrira de nombreux débouchés, surtout pour les entreprises actives dans les secteurs à haute technicité en amont des systèmes informatiques et de communication.
Le champ d’activité des entreprises passera de la simple réalisation de projets conçus par des spécialistes hors-entreprise à une offre plus globale incorporant planification, mise en réseau, coordination, réalisation, et parfois même financement de projets répondant non seulement à une demande spécifique, mais offrant une solution complète et intégrée au client. L’artisan est en passe de devenir un véritable partenaire de l’ingénieur ou de l’architecte, alors qu’il était simple exécutant auparavant. Les demandes techniques toujours plus poussées accéléreront cette évolution, et la communication autour des projets de plus en plus complexes prendra énormément d’importance.
Les entreprises artisanales d’aujourd’hui sont peu énergivores, si ce n’est pour leurs déplacements en véhicule auprès des clients. Cette donne ne changera probablement pas, et leur consommation en énergie diminuera au même taux que le permettra l’installation des meilleures technologies possibles. Elles contribueront cependant grandement à la réduction de la facture énergétique de l’économie et du pays entier par la mise en place et l’entretien d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et de mesures d’épargne énergétique, comme l’isolation thermique. Ainsi dopé par la demande privée et institutionnelle, le secteur de l’énergie occupera à l’horizon 2020 pas loin de 5.000 personnes.
Le chef d’une entreprise artisanale ne travaillera plus dans ‘son métier’, mais sera manager, concepteur, organisateur, facilitateur, tantôt directeur technique, tantôt DRH, tantôt directeur financier, si ce n’est que son entreprise aura, entre-temps, pris assez d’importance pour avoir une structure spécifique répondant à toutes ces obligations de leader. Dans la plupart des cas, il ne sera plus maître-artisan, mais ingénieur, économiste, ou bien il sera détenteur d’un autre diplôme, souvent universitaire.
Le problème des zones d’implantation ira en s’accroissant
Mais le tableau contient aussi des zones d’ombre, les mêmes, je le crains, que celles qui nous préoccupent aujourd’hui. La formation continue prendra de plus en plus d’importance dans les entreprises, les collaborateurs ne disposant pas du bagage nécessaire pour pouvoir productivement s’intégrer dans les entreprises où les exigences ne cesseront de croître. Pour ce faire, l’initiative privée dans le domaine de la formation continue sera davantage structurée, en suivant l’exemple du secteur de la construction. La concurrence entre entreprises et secteurs pour les rares collaborateurs qualifiés s’intensifiera, alors que l’école n’aura probablement toujours pas réussi à améliorer tant le niveau de qualification que le degré de réussite des élèves. La formation initiale restera également en l’an 2020 le talon d’Achille de notre évolution sociétale et économique.
Dans de nombreux secteurs, notamment l’alimentation artisanale, la course à la concentration et à la taille critique, pour la rentabilisation des investissements, fera en sorte que le nombre d’entreprises sera de plus en plus réduit, alors que les installations prendront des envergures quasi industrielles. S’y ajouteront encore des évolutions du cadre réglementaire du genre «étiquetage» ou «allergènes», que des entreprises de type PME auront de plus en plus de difficultés à remplir.
Tout ceci ne va pas nécessairement au détriment de la qualité, mais certainement au détriment de l’originalité et de la créativité, sans pour autant améliorer la qualité des aliments, comme le montrent les évolutions. Tant que le consommateur ne sera pas prêt à dépenser le juste prix pour des aliments de qualité, cette évolution ne saura être inversée, malgré tous les scandales ayant ébranlé le secteur de la viande, notamment.
Alors que les aides publiques sont assez bien étoffées de nos jours pour pouvoir accompagner la création ou la reprise d’entreprises de taille somme toute modeste, l’accès à des capitaux plus importants reste difficile, faute d’instruments et en raison de l’absence, parmi les financiers luxembourgeois, de culture du capital-risque et de capital de démarrage d’une certaine envergure. Ces difficultés seront plus importantes encore en 2020, alors que les entreprises prendront énormément de valeur au vu des évolutions décrites plus haut. À ceci s’ajoute un cadre réglementaire du secteur financier qui rendra plus difficile encore l’accès au crédit des PME – je parle de Bâle IV.
Le problème des zones d’implantation ira en s’accroissant. Après la publication, en 2012, des différents plans sectoriels, une vague de spéculations sans précédent sur les terrains prévus pour des activités artisanales, commerciales et industrielles a réduit à néant les plans du gouvernement de pouvoir peu à peu mettre des terrains supplémentaires à disposition des entreprises. Les procès d’expropriation ensuite entamés par le gouvernement envers les spéculateurs perdurent en 2020 et aucune solution n’est en vue, si ce n’est l’abandon de la politique poursuivie depuis les années 90 du siècle précédent, qui consiste en une raréfaction systématique du terrain disponible par le jeu des autorisations.
Les tracasseries administratives atteignent de nouveaux records négatifs, et tous les efforts des gouvernements successifs depuis 2004 s’avéreront vains contre l’avalanche de textes légaux, réglementaires et administratifs produits par une multitude de gens bien pensants dont la vue malheureusement ne dépasse que rarement le fameux bord de l’assiette. De plus en plus nombreux seront les procès menés par les entreprises exaspérées contre des décisions administratives contradictoires, arbitraires, voire abusives.
La formation initiale restera également en l’an 2020 le talon d’Achille de notre évolution sociétale et économique.
La réforme administrative continue à traîner du pied, le gouvernement précédent qui avait essayé de solutionner le problème ayant été battu aux élections par un large front de Luxembourgeois employés dans le secteur public et peu enclins au changement. En 2020, les entreprises sont cependant tout autant bloquées dans leur évolution par les interminables bouchons de la circulation que par les tracasseries administratives. En effet, le chaos journalier sur les routes leur coûtera la bagatelle de 25% du temps productif, faute de politique des transports cohérente et à cause des décalages répétitifs de l’élargissement du réseau autoroutier pour des raisons budgétaires.
La concurrence pour les entreprises artisanales luxembourgeoises bat de nouveaux records. Aux concurrents majoritairement européens de 2010 se sont ajoutés le Proche et le Moyen-Orient, ainsi que l’Inde, la Chine, et même des pays du continent sud-américain pour la fourniture de nombreux biens intermédiaires, utilisés dans la construction, notamment. Pour faire face à cette situation de compétition accrue, les entreprises recourent à des méthodes et techniques de production inédites de nos jours, tels des modules de construction préfabriqués et l’utilisation de robots dans la construction.
Les entreprises devront sans relâche se repositionner et se requalifier. Les nouvelles technologies utilisées dans l’automobile ne resteront pas non plus sans conséquence sur les métiers concernés, qui s’adapteront aux propulsions hybrides, électriques ou à la chambre de combustion, tout comme aux nouveaux matériaux plus légers utilisés dans le futur. Dans d’autres domaines, les considérations liées au développement durable feront que de plus en plus d’articles journaliers seront réparés plutôt que jetés, ce qui procurera à l’artisanat de nouveaux créneaux dans l’entretien et la réparation.
Le principal client de l’artisanat reste le secteur public, l’État et les communes. Mais plus nombreuses que jamais sont les entreprises qui se désintéressent complètement de ce client, fût-ce parce qu’il s’agit d’un mauvais payeur, fût-ce parce que les soumissions publiques continuent également en l’an 2020 à privilégier l’entreprise générale et la sous-traitance à la clé.
Gare au retour en arrière
Le futur, je l’avais dit en introduction, nous réservera certainement des évolutions contrastées, présentant des aspects négatifs et positifs, tout comme des opportunités d’affaires nouvelles, pour les entreprises artisanales et pour les autres secteurs. À côté de la formation initiale, dossier certes épineux, le défi majeur pour l’économie luxembourgeoise restera, je le crains, également en 2020, la perte continue de compétitivité-coût. Il s’agit là du problème majeur qui devrait nous occuper tous, mais que la majorité préfère taire, pour des raisons de commodité.
Sans même parler des vaches sacrées luxembourgeoises, comme l’indexation intégrale et automatique des salaires, les entreprises auront de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Les charges sociales auront atteint ou seront sur le point d’atteindre à ce moment-là de nouveaux sommets inédits jusqu’alors. L’assurance-maladie coûtera de plus en plus cher, alors que toutes les réformes menées jusque-là auront évité de responsabiliser les acteurs concernés.
En assurance-pension, le décaissement des réserves accumulées depuis des décennies est imminent en 2020; elles tiendront au plus 10 années avant que les responsables politiques ne soient obligés d’augmenter les prélèvements obligatoires de façon spectaculaire pour atteindre presque 50% des revenus générés au bout de 20 années supplémentaires.
Malgré toutes les belles évolutions décrites plus haut, et à moins de pouvoir trouver des solutions permettant aux entreprises – surtout celles à forte composante de main-d’œuvre, comme les entreprises artisanales – d’améliorer leur situation concurrentielle, le Luxembourg dans son ensemble risque le retour en arrière vers une petite économie complètement dépassée par les événements et sans intérêt pour les grands du monde, alors que la musique jouera autre part. Carpe diem!»
Lire aussi