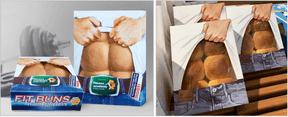Vous souvenez-vous de la première publicité que vous avez épinglée? Comment est né Joe La Pompe?
Joe La Pompe. – «C’était il y a 25 ans, dans l’agence où je travaillais. Une campagne Perrier mettait en scène un vacancier sur une plage, emmitouflé dans un ‘short-doudoune’, pour illustrer la fraîcheur extrême de la boisson. L’idée était simple, le visuel percutant. Le directeur de création en était très fier, il l’avait même affichée dans son bureau et avait remporté des prix avec. Il nous présentait cette pub comme un modèle à suivre. Jusqu’au jour où je tombe, par hasard, sur une pub quasi identique pour une bière britannique… datant de trois ans plus tôt. Même concept, même visuel. J’étais stupéfait. J’en ai parlé au créatif, qui m’a répondu, un peu gêné, que c’était sûrement une coïncidence. Mais c’était trop ressemblant. J’ai publié ça pour moi, comme une archive. Puis j’ai cherché d’autres cas, dans des magazines, des livres, sur internet… Et j’ai commencé à en trouver. Deux, puis trois, puis des dizaines. C’est là que le projet a vraiment pris forme.
Vous apparaissez toujours cagoulé. Comment gérez-vous cet anonymat dans votre vie professionnelle? Des proches connaissent-ils votre identité?
«La cagoule, c’est avant tout un personnage, un jeu. Au départ, je ne portais pas de masque. Mais le sujet du plagiat est sensible, parfois mal perçu, et comme je travaillais alors en agence, l’anonymat me protégeait. L’idée de la cagoule est venue plus tard. Au départ, je publiais depuis chez moi, derrière un ordinateur. Puis, à mesure que le site a gagné en notoriété, que les invitations, les interviews, les livres se sont enchaînés, il a fallu trouver un moyen de ne pas montrer mon visage. J’ai testé plusieurs déguisements, mais aucun ne convenait vraiment. Je voulais quelque chose d’original, parce que je défends l’originalité, et surtout rapide à enfiler. La cagoule s’est imposée: elle évoque un côté justicier masqué que je trouve rigolo. Je l’associe à un t-shirt au logo recyclé, histoire d’apporter un peu de légèreté.
Votre accoutrement n’est pas sans rappeler celui des Daft Punk ou de Banksy. Vous ne seriez pas, vous aussi, un peu dans la copie?
«L’analogie revient souvent, mais il faut relativiser. Mon personnage évolue dans un univers B2B très ciblé. Mon travail ne s’adresse pas au grand public. Dès le début, j’ai choisi de me concentrer sur le plagiat publicitaire, un domaine que je connais de l’intérieur. On m’a déjà suggéré d’élargir à d’autres disciplines, car le plagiat touche bien d’autres secteurs – webdesign, logos ou d’autres disciplines créatives – mais je préfère rester sur un terrain que je maîtrise. C’est un travail qui demande du temps, de la rigueur et une vraie connaissance du terrain. Je laisse à d’autres le soin d’explorer les autres sphères.

Cette publicité Perrier est celle qui a déclenché la mission de Joe La Pompe. (Photo: Joe la Pompe)
Votre masque intrigue, mais votre pseudonyme aussi. Pourquoi avoir choisi «Joe La Pompe»?
«Le nom est né un peu par hasard, sans stratégie. En agence, on appelait ‘Joe La Pompe’ quelqu’un qui copiait – une expression familière qui m’a fait sourire. ‘Joe’ sonnait bien pour un personnage et ce nom provocateur, qui évoque la copie dès le départ, a rapidement marqué les esprits. Il annonçait la polémique et a contribué à l’identité du projet. À l’international, c’est plus flou: les anglophones ne comprennent pas toujours le sens, certains pensent que je m’appelle Joël, d’autres que ‘La Pompe’ est mon nom de famille. Aujourd’hui, difficile de revenir en arrière, mais si c’était à refaire, je choisirais peut-être un autre nom.
Vous dénoncez des pubs venues des quatre coins du monde, parfois de pays inattendus comme le Brésil. Comment dénichez-vous ces campagnes? C’est un travail chronophage, non?
«Au départ, je me concentrais surtout sur la publicité française – je suis originaire de France. Mais j’ai vite constaté que certaines campagnes locales reprenaient des idées venues d’ailleurs. Avant internet, les directeurs artistiques s’inspiraient de livres ou magazines étrangers et pouvaient reprendre des concepts sans que personne ne le remarque. Aujourd’hui, je surveille les campagnes du monde entier. Je ne peux évidemment pas tout connaître, mais je suis attentivement les grands festivals de publicité, qui offrent un panorama international. J’archive, je compare, je publie. Mon site, initialement en français, a rapidement trouvé un public mondial. J’ai reçu des messages d’Indonésie, d’Afrique, d’Amérique du Sud… Ce qui m’a poussé à ajouter un peu d’anglais au fil du temps.
Comment repérez-vous une pub copiée? C’est une intuition de chasseur ou une méthode bien rodée?
«Un peu des deux. Il y a l’intuition: je tombe sur une pub et j’ai ce réflexe – ‘ça, je l’ai déjà vu’. Je la mets de côté, puis je cherche la source. Parfois, je retrouve l’originale en quelques minutes, parfois des années plus tard, par hasard. L’autre canal, ce sont les signalements: je reçois beaucoup de messages, parfois très bien argumentés, de gens qui agissent comme des lanceurs d’alerte. Ensuite, je trie. Certains cas sont très nets, d’autres beaucoup moins. J’essaie de ne publier que les ressemblances les plus flagrantes. Parfois, on m’envoie deux pubs juste parce qu’elles utilisent la même typo, un même mot ou un crocodile dans l’image… Ce n’est pas suffisant pour parler de plagiat. Il y a aussi un vrai travail de pédagogie à faire sur ce qu’est une idée originale.

Joe La Pompe, masqué comme à son habitude. (Photo: Emilio Naud/Paperjam)
Justement, où se situe, selon vous, la frontière entre plagiat et inspiration?
«C’est la grande question et elle est loin d’être simple. Je travaille seul, donc il y a forcément une part de subjectivité. Ma règle: les deux pubs doivent être si proches qu’on se dit instantanément ‘c’est la même chose’. Si une campagne réinterprète ou enrichit l’originale, je peux choisir de ne pas la publier. C’est une décision forcément personnelle. C’est d’ailleurs le seul moment où j’interprète. Le reste du temps, je me contente de mettre les images face à face. Je ne tranche jamais. Je ne dis pas ‘c’est un plagiat’, mais plutôt ‘voici deux campagnes qui se ressemblent, à vous de juger’. Mon rôle, c’est de documenter un phénomène, pas de rendre des verdicts.
Vous est-il déjà arrivé de préférer une copie à l’originale?
«Oui, et heureusement. Tout dépend de l’intention et de l’exécution. Beaucoup se contentent de copier sans comprendre, et le résultat est souvent médiocre. En revanche, lorsqu’une idée existante est utilisée comme point de départ, qu’on y injecte sa propre vision, une valeur ajoutée, une réinvention… là, on change de registre. Ce n’est plus vraiment une copie. L’essentiel, c’est que l’idée originale serve de tremplin – pas de destination finale.
À l’ère de l’IA et face à l’immensité du déjà-vu, peut-on encore être vraiment original ou ne fait-on que réagencer l’existant?
«D’abord, est-ce que tout a déjà été fait? On entend souvent cette idée, mais j’ajoute toujours: pas de toutes les manières. La majorité des pubs que je vois restent originales. Les formats changent, les médias évoluent, de nouvelles formes d’expression émergent. La pub recycle, oui, mais elle transforme. Et ce n’est pas un problème: on ne crée jamais à partir de rien. La publicité, c’est avant tout l’art d’absorber les tendances et de les transformer.
On ne crée jamais à partir de rien.
Concernant l’IA, la question est plus délicate. Elle peut générer une image percutante sans vous dire qu’elle existe déjà. C’est un outil puissant pour copier, mais risqué pour créer. J’ai vu, par exemple, une image générée par IA d’un poisson fumant une cigarette, censée dénoncer la pollution marine. L’idée est forte – mais elle existait déjà depuis des années, en photomontage. L’IA ne vous en avertira pas. C’est une limite importante et un vrai risque pour les créateurs.
Avec les outils numériques, le plagiat est-il plus fréquent aujourd’hui ou simplement plus visible?
«Le plagiat a toujours existé. J’ai cru qu’avec internet, les bases de données et la recherche par image, il serait plus simple de prévenir les doublons. En réalité, le volume de création est devenu tel qu’il est quasiment impossible de tout suivre. Des milliers de campagnes sortent chaque année, sur tous les supports, dans tous les pays. Même avec les outils d’aujourd’hui, retrouver une idée déjà exploitée revient souvent à chercher une aiguille dans une meule de foin. Même avec les outils actuels, comme la recherche par image ou l’intelligence artificielle, cela reste extrêmement complexe. L’IA pourra peut-être aider sur ce sujet.
Les cas de plagiat que vous pointez donnent-ils souvent lieu à des poursuites judiciaires?
«Mon site relève plus de l’éthique créative que du droit. La plupart des cas publiés impliquent des idées reprises d’un autre pays, d’une autre époque ou d’un autre secteur. Les vraies problématiques juridiques apparaissent surtout quand deux marques concurrentes, sur un même marché, dans un même pays, se retrouvent avec des campagnes similaires. Là, il peut y avoir contentieux, mais c’est relativement rare. Il est peu probable qu’une marque européenne soit attaquée pour avoir repris une idée diffusée en Indonésie il y a 20 ans. Cela ne mène pas au tribunal, mais finit sur mon site – ce qui, pour les créatifs concernés, peut être tout aussi dommageable. Cela entame leur crédibilité.
Vous est-il déjà arrivé vous-même de franchir la ligne?
«Oui, deux fois. La première, sans le savoir: une campagne qu’on croyait originale existait déjà en Argentine. On a tout de même sorti la pub, mais je ne l’ai jamais envoyée en festival, ni ajoutée à mon portfolio. La seconde, plus grave, était un plagiat assumé. J’étais jeune, sous pression, dans une agence où l’on devait présenter cinq pistes créatives au client en un temps record. J’avais 20 ans, je manquais d’idées et je me suis souvenu d’un dessin humoristique vu dans un livre. Ce n’était pas une pub, juste une illustration. J’ai repris l’idée, pensant que cela passerait inaperçu. Le client a adoré et c’est cette version qui a été retenue. Trop tard pour faire marche arrière. Je me suis dit que l’auteur était décédé, qu’il n’y aurait pas de suite… Mais le lendemain de la parution, la veuve du dessinateur a contacté l’agence. Un procès a suivi, l’agence a payé cher. J’ai failli perdre mon poste. J’ai tenté de me justifier avec un ‘les grands esprits se rencontrent’… mais je savais que j’avais franchi la ligne. Ça m’est arrivé une fois et je me suis promis de ne plus jamais me remettre dans un pétrin pareil.»