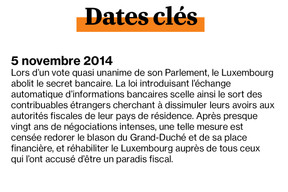L’histoire et le développement de la gestion de patrimoine au Luxembourg sont indissociables de ceux du secteur financier dans son ensemble. Et s’il faut attendre le début des années 80 pour assister au véritable essor de ce secteur qui enregistre aujourd’hui des records, notamment en termes d’actifs sous gestion, les premiers jalons de ce succès planétaire ont été posés plusieurs décennies auparavant.
De la «Holding 1929» à la naissance de l’eurodollar
Peu le savent, mais, dès 1929, le Luxembourg crée un premier cadre favorable aux activités financières offshore. Il s’agit de la «Holding 1929» et de la Bourse de Luxembourg, deux outils sur lesquels le pays va bâtir son ascension. Concrètement, les holdings, ou sociétés mères, n’avaient alors pas le droit d’avoir d’activité commerciale ou industrielle dans le pays. Leur utilité était de permettre à de grandes sociétés françaises, belges, allemandes, voire britanniques ou américaines, de rassembler leur capital au Luxembourg en l’exonérant d’impôt.
Lire aussi
En effet, les «H29» étaient uniquement assujetties à un droit d’enregistrement, à un droit de timbre et à un droit d’abonnement. Pour le gouvernement de l’époque, l’enjeu était double: engranger de nouvelles rentrées fiscales et attirer au Luxembourg des capitaux pour alimenter son industrie sidérurgique. Avec le krach boursier de 1929, puis la Seconde Guerre mondiale, il faudra toutefois attendre la fin des années 50 pour connaître l’âge d’or des H29 et de la Bourse avec la naissance des eurodollars, qui constituent, en quelque sorte, le premier marché transnational de l’épargne, et vont ensuite contribuer à l’essor de la banque privée au milieu des années 80.

Depuis 2008, les actifs sous gestion privée ne cessent d’augmenter. (Visuel: Maison Moderne)
À la fin des années 50, accélère la naissance de la Place. Alors que les activités bancaires sont strictement encadrées, les besoins de financement pour la reconstruction d’après-guerre sont gigantesques. C’est dans ce but qu’apparaissent les eurodollars. Ce nom désignait les dollars détenus hors des États-Unis. Des dollars qui, grâce au plan Marshall, s’accumulent dans les livres des banques européennes et qui seront utilisés dans des opérations de prêts internationaux.
La souplesse de la réglementation
En 1963, fait entrer le Luxembourg dans le cercle fermé des places financières internationales. À l’époque, l’émetteur est italien, le contrat d’admission est régi par le droit anglais, la place de cotation est au Luxembourg et l’emprunt est libellé en dollars. Admis à la cote de la Bourse de Luxembourg le 17 juillet 1963, l’emprunt porte sur un montant de 15 millions de dollars avec un taux d’intérêt de 5,50% et une maturité de 15 ans.
Si le Luxembourg est choisi pour l’émission de cette obligation, c’est pour la souplesse de sa réglementation. Les législations adoptées à la fin des années 20 s’avèrent enfin payantes et s’épanouissent avec le développement de ce qu’il convient d’appeler le «marché transnational de l’épargne». Selon le Premier ministre de l’époque, Pierre Werner: «Les investisseurs ne trouvant pas l’avantage d’un régime de faveur ou de liberté à Luxembourg le trouveraient aisément ailleurs.»
Les euro-obligations ouvrent de nouvelles perspectives pour la Place: les banques locales débordent de leur marché domestique pour devenir des banques d’affaires internationales et les banques étrangères prennent pied au Grand-Duché. Elles sont encouragées par la création, en 1965, de la holding de financement, une structure permettant à des groupes internationaux de structurer leurs emprunts obligataires dans un cadre fiscal attrayant. Les titres de ces emprunts étaient exemptés de retenue à la source.
Après la Seconde Guerre mondiale, le pays ne comptait que 10 banques. Elles étaient 26 en 1967. Et 100 en 1979. Les années 70 sont celles des pétrodollars. Cet afflux de liquidités lance un nouveau marché, celui des eurocrédits. Des prêts destinés au financement des États qui, à la fin des accords de Bretton Woods en 1971, ouvrent les vannes de l’endettement. Un nouveau marché s’ouvre pour la Place, qui attire encore plus d’acteurs et de services. Les banques saisissent les nouvelles opportunités qui se présentent et développent des services (agents payeurs, agents de cotation, dépositaires). La Place a besoin d’avocats pour rédiger les prospectus et les contrats d’émissions, de notaires, mais aussi d’auditeurs.
L’essor de la banque privée
Au début des années 80, la Place a atteint une certaine maturité. C’est aussi à cette période qu’apparaissent les premières difficultés. La croissance mondiale ralentit en raison de l’inflation et en particulier d’une nouvelle hausse des prix du pétrole, due à la guerre entre l’Irak et l’Iran.
Mais la situation ne dérape véritablement qu’en 1982, lorsque le Mexique décide unilatéralement de geler le paiement de sa dette. La situation d’insolvabilité des pays d’Amérique latine, principaux clients du Luxembourg sur le marché des eurocrédits, frappe durement la Place.
Face à ces difficultés, elle cherche à diversifier ses activités, notamment en direction du private banking et des fonds d’investissement. Des choix qui vont s’avérer pertinents dans un contexte de libéralisation progressive des capitaux. En matière de banque privée, la Place ne part pas de zéro. Sa participation aux euromarchés l’a, dès les années 60, familiarisée à une clientèle internationale, à des produits d’investissement en différentes devises, ainsi qu’à l’élaboration de montages complexes. fera pencher la balance…
Le secret bancaire n’explique cependant pas à lui seul le succès de la banque privée. Il s’appuie sur deux auxiliaires précieux: le principe de la non-imposition de l’épargne des non-résidents et le principe de la double incrimination en matière de délit fiscal. Concrètement, si l’échange d’informations avec des administrations fiscales étrangères était possible dans le cas d’une procédure pénale, il fallait que la définition de l’infraction suspectée soit similaire à celle existant dans le droit grand-ducal. Qui avait une conception limitée du délit de fraude fiscale.
La fin du secret bancaire
Le secret bancaire va assurer l’essor de l’industrie de la banque privée et de la gestion de patrimoine. Ce qui n’ira pas sans quelques grincements de dents de la part des États voisins, dont les ressortissants étaient les principaux clients de la Place. C’était l’époque du «dentiste belge». L’image de la Place va peu à peu se dégrader. Au grand dam des professionnels de l’assurance et des fonds d’investissement qui n’avaient que faire de ce secret.
Un événement dramatique sera à l’origine de la fin du secret bancaire: le 11 septembre 2001 et les attentats contre les tours du World Trade Center. Du jour au lendemain, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme s’inscrit en bonne place dans l’agenda des autorités américaines. Le secret bancaire n’est dès lors plus tolérable. De concession en concession, il va disparaître.

Depuis 2008, les actifs sous gestion privée ne cessent d’augmenter. (Visuel: Maison Moderne)
Une disparition très progressive qui sera actée le 5 novembre 2014 par le vote, à la Chambre des députés, de son abolition et de l’introduction de l’échange automatique d’informations bancaires. 14 années que les professionnels du secteur vont mettre à profit pour repenser leur modèle. Avec succès. Avec la fin du secret bancaire, certains prédisaient un avenir morose pour le secteur de la banque privée au Luxembourg. Force est de constater que le secteur est parvenu à se réinventer en s’adressant à une nouvelle clientèle, beaucoup plus fortunée que par le passé.
Un nouvel écosystème plus vertueux
Au fil du temps, cette offre s’est transformée en un écosystème complet de gestion de patrimoine, regroupant le conseil en investissement, la gestion d’actifs, la planification patrimoniale, la gestion immobilière, la planification de la succession et la philanthropie. Le Luxembourg fait aujourd’hui office de centre d’excellence pour la gestion multijuridictionnelle de patrimoine. De nombreux groupes bancaires ont établi leur centre de compétences intragroupe au Luxembourg afin de répondre aux besoins de leurs clients.
Ce rôle particulier dans la chaîne de valeur de la gestion de patrimoine internationale a été considérablement renforcé par la décision de grandes institutions financières, dont JP Morgan et la Banque de Singapour, d’établir leurs opérations de gestion de patrimoine post-Brexit dans l’UE au Luxembourg. La transition vers un centre de gestion de patrimoine transfrontalier fiscalement transparent au lendemain de la crise financière avait déjà renforcé la position du Luxembourg en tant que pôle européen onshore pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et leurs clients.
Le secteur a continué à se diversifier dans les segments de clientèle ultra-fortunée, les actifs sous gestion atteignant 600 milliards d’euros à la fin de 2021. Une histoire qui continue de s’écrire aujourd’hui, dans un cadre réglementaire toujours plus contraignant, mais qui laisse encore la part belle aux opportunités.
Cet article a été rédigé pour de l’édition de parue le 14 décembre 2022. Le contenu du magazine est produit en exclusivité pour le magazine. Il est publié sur le site pour contribuer aux archives complètes de Paperjam.
Votre entreprise est membre du Paperjam + Delano Business Club? Vous pouvez demander un abonnement à votre nom. Dites-le-nous via